Tu te rappelles, dis ? – Trilogie d’un oubli
- Selene De Beaumont
- 2 juil. 2025
- 4 min de lecture
Tu te rappelles, dis ? – Trilogie d’un oubli
Trois soirs. Trois visages. Une mémoire qui se défait à force d’aimer dans le noir.
I – Le flou
Ce soir, ton visage est flou.
Je n’arrive plus à reconstituer tes traits.
Ton sourire, celui qui partait sur le côté — je l’aimais tant.
Mais là, je ne le retrouve plus.
Ni la forme exacte de tes lèvres.
Comme si ma mémoire m’abandonnait aussi.
Tu te rappelles, dis ?
Les mains qui ne s’y trompaient pas.
Les conversations douces.
Les silences pleins.
Et ce frisson sous la peau quand je prononçais ton nom sans le dire.
Tu te rappelles ?
Moi, je n’ai rien oublié.
Et pourtant ce soir, je te vois en morceaux.
Comme ce film qu’on avait vu : Dans ma peau.
Tu es fragmenté, comme un souvenir trop touché.
Tu t’effaces.
Mais je t’ai rêvé cette nuit — tout entier, ton corps, ta voix, tes silences…
Tu m’as traversée,
et j’ai porté cette brûlure toute la journée.
Je ne veux pas chercher de photo.
Je ne veux pas ouvrir les vannes de ma peine.
Je t’ai écrit que tu n’étais plus le bienvenu.
Et pourtant, tu es tout ce que j’espère.
Mais pas ainsi : pas flou, pas à reculons, pas voleur.
Je ne te veux pas fourbe.
Je te veux vrai.
Droit.
Celui d’avant, je crois — celui qui disait la vérité, même quand elle piquait.
J’ai vu une part de toi que toi-même tu ne connais pas encore.
Et je l’ai aimée sans hésiter.
J’étais là.
Présente.
Je n’ai jamais fui, jamais couru ;
j’ai juste tenu, espéré, attendu.
Et à force… j’ai compris que c’est toi qui as lâché ma main.
Alors je te le demande une dernière fois, doucement, dans ce flou qui me brûle :
Tu te rappelles, dis ?
II – Le vertige
Ce soir, ta voix s’est effacée.
Pas par choix, ni pudeur : par trou noir.
Je n’arrivais plus à me souvenir du bruit que tu fais quand tu ris.
Ce rire de paysanasse — mot que j’ai inventé parce que rien d’autre ne colle.
Un rire franc, un peu gras,
qui jurait avec la préciosité de tes mots choisis.
Et moi je riais quand tu lâchais tes jurons :
des caresses révoltées, des tendresses qui mordent.
Aujourd’hui, ce n’est plus ça qui me fauche.
Ce ne sont pas tes contrastes.
C’est ton silence.
Tes yeux noirs sans âme.
Un vide où je ne suis plus rien.
Et puis, tout à l’heure, j’ai repensé à ça :
tu réussissais à tout mettre en bouche d’une seule bouchée.
Les biscuits italiens, dévorés en un soir.
Un détail, mais ça m’a saisie.
J’ai paniqué : j’ai cherché des photos.
Mais j'ai renoncé.
Je n’ai pas eu le courage.
Ou plutôt si, j'ai eu le courage.
Pourtant, je me suis dit :
Si j’oublie même ta voix, alors qu’est-ce qu’il me reste de nous ?
Puisque c’est moi qui porte la mémoire.
Tu te rappelles, dis ?
Les silences qui ne faisaient pas peur,
les battements accordés,
les jours de soleil à s’attendre,
à se chercher,
et cette manière d’être aimés qui rendait invincible.
Moi, je me rappelle.
Je t’ai rêvé cette nuit, entier ;
et toute la journée, ça m’a brûlée de l’intérieur,
parce qu’au réveil tu n’étais plus là.
Je t’ai vu fuir ce que tu ne savais pas tenir,
et malgré ça je t’ai aimé sans hésiter.
Non, je n’invente rien.
Même ce soir, sans ton visage ni ta voix,
je sens la trace que tu as laissée sous ma peau.
C’est moi qui porte la mémoire,
c’est moi qui suis restée,
et c’est moi, ce soir, qui ai le vertige — mais pas le doute.
Tu étais là. Et tu as lâché ma main.
III – Le soleil
Ce soir, il reste dans le monde des échos de toi.
Lointains.
Ils ne naissent plus en moi.
Ils viennent de dehors et me giflent,
avec dextérité,
avec précision :
une silhouette qui te ressemble,
un mot que tu aimais dire,
un moment auquel je ne pensais plus,
quelque chose que tu aimais, et qui revient.
Ce sont les seules choses qui reviennent.
Des témoins courageux de ce que tu aurais pu être.
Des lanternes dans la nuit où tu nous as enfermés.
Aujourd’hui, je vois enfin le soleil.
Et je me dis: Tiens, je me rappelle...
Avant, j’étais en colère de te porter.
Cette colère a disparu,
et avec elle le poids de ce que je nourrissais encore.
Ne reste que le chagrin de rappels que je n’ai pas appelés.
Et cette phrase, encore, dans ma tête : Tu te rappelles, dis ?
Peut-être qu’un jour je croiserai tout ça en ayant oublié.
Peut-être que la sensation de tes cheveux entre mes doigts me quittera.
Peut-être que je les trouverai stupides, ces cheveux.
Peut-être.
Peut-être que ta silhouette fine me semblera une erreur d’appréciation.
Peut-être que je me trouverai curieuse.
Peut-être.
Peut-être que tes yeux seront un souvenir incolore.
Peut-être que je les trouverai vides.
Peut-être.
Peut-être que tes mots ne résonneront plus dans mes rêves.
Peut-être que je les trouverai faux, ou inconsistants.
Peut-être.
Peut-être que je ne saurai plus si tout cela a existé, enfin nous deux.
Peut-être que je nous trouverai ridicules, comme un film trop naïf qu’on finit par détester.
Peut-être.
En attendant, je dépose un peu de toi chaque jour.
Et, plus légère, je dépose enfin des pas pour moi.
J’ai ouvert mon cœur à la vie.
Elle me le rendra, je crois.
Puisque toi, tu ne rends rien.
Je t’imagine dormir du sommeil du juste,
celui qui pense qu’il a pris la bonne décision
parce qu’il faudrait être fou pour aller contre son cœur,
ou avoir si honte,
ou être encore un enfant.
Peut-être. Je ne sais pas.
Alors je t’imagine heureux, libre, insouciant :
avec des attaches pour jouer, et sans attaches tout court.
J’imagine que tu es heureux.
Je t’interdis de ne pas l’être.
Et j’imagine que je m’en approche.
Peut-être.
Selene












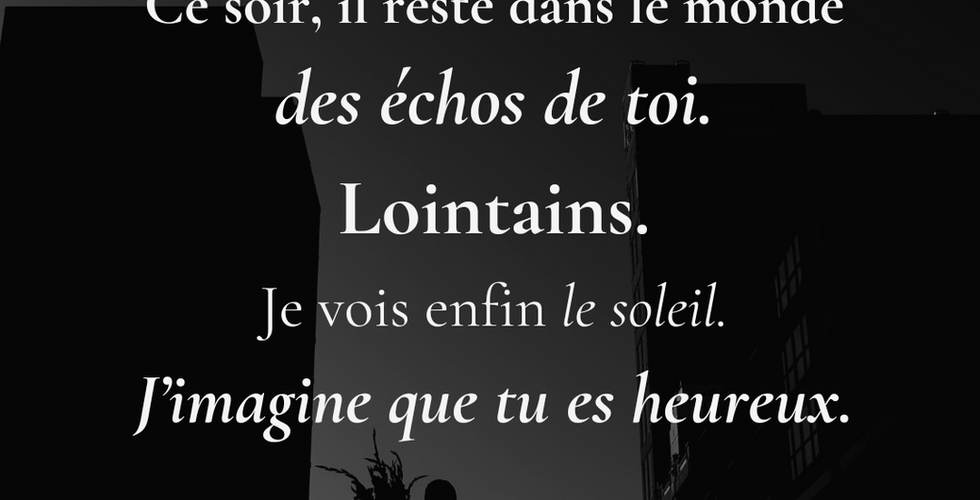





Votre texte m’a traversé. Pas comme un simple souvenir d’amour, mais comme un long murmure d’âme,où chaque mot cherche sa juste place, même dans l’absence, même dans la fin.
J’ai lu le flou, le vertige, puis la lumière, et tout m’a semblé profondément vivant. Pas parce que vous tenez encore,mais parce que vous déposez sans renier. Parce que vous aimez encore, sans possession.
Il n’y a pas de plainte, pas de vengeance,juste la lucidité nue de celle qui a été là,jusqu’au bout. Et qui, à force d’aimer dans le noir,a fini par rallumer son propre feu.
C’est rare, cette clarté-là. Et c’est beau.